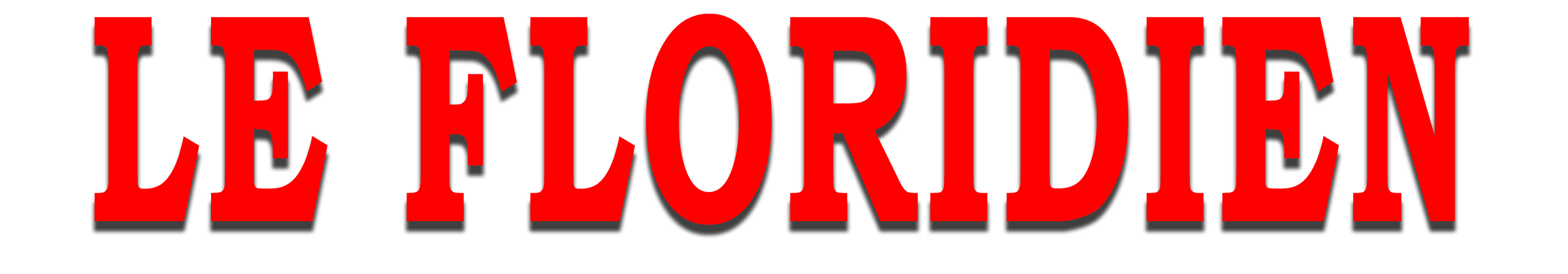Par Dessalines Ferdinand & Stéphane Boudin
Deux siècles. Deux cents longues années depuis qu’un roi français, assis sur un trône en déclin, a exigé d’un peuple libre qu’il paie.. pour sa liberté. En 1825, Charles X imposait à Haïti une dette coloniale d’une violence économique inédite, dont les effets ravagent encore nos institutions, notre économie, notre dignité. Aujourd’hui, alors que l’Élysée promet des « gestes symboliques », il est temps de rappeler que l’histoire ne se répare pas avec des discours. Il faut agir. Et il faut que la société haïtienne, cette fois, tienne bon. Car si on laisse passer ce bicentenaire, on n’aura que nos silences à blâmer.
Il faut relire les chiffres pour se rappeler l’ampleur du scandale. En 1825, Haïti est contraint de payer 150 millions de francs or à la France pour compenser les pertes des anciens colons. Une somme gigantesque pour l’époque, équivalente à des dizaines de milliards d’euros actuels. Le tout, sous la menace d’une escadre militaire française prête à bombarder Port-au-Prince. Une saignée vive dont on ressent les symptômes encore de nos jours.
Au regard du droit international, ce que la France a exigé d’Haïti est tout sauf une transaction. C’est un braquage diplomatique. Et le mot est faible. On a beau retourné le problème dans tous les sens, aucune justification ne peut expliquer une telle imposition, si ce n’est la volonté du plus fort à imposer sa loi.
Encore grisés par l’indépendance nouvellement acquise, nos aïeux ne pensaient pas que cette extorsion étatique allait nous plomber pendant des siècles. Car avec cette « rançon de l’indépendance », notre jeune nation a dû s’endetter auprès des banques françaises, à des conditions usuraires. Ce cercle vicieux — payer les bourreaux pour qu’ils acceptent notre liberté — a condamné Haïti à une spirale de dépendance financière et de sous-développement chronique.
Il nous a fallu presque un siècle pour solder cette dette injuste, privant notre pays de ses moyens de développement. En plus d’étrangler nos finances publiques, cette dette a aussi nourri l’ingérence étrangère et institutionnalisé la précarité. Pendant que d’autres jeunes nations investissaient dans des écoles, des hôpitaux, des infrastructures, nous, nous remboursions l’inacceptable.
Il ne s’agit pas ici de remuer le passé pour le plaisir. Il s’agit de comprendre que l’actuelle pauvreté haïtienne n’est pas un accident de l’histoire, mais une conséquence directe d’une injustice économique légalisée par la France. Voilà pourquoi les réparations ne sont pas une faveur. Elles sont une nécessité historique, morale et politique.
Macron, la rhétorique sans le chèque ?
Dernièrement, Emmanuel Macron a promis des « gestes symboliques ». Le président français ne parle ni de remboursement, ni de restitution, encore moins de réparation. Il parle de mémoire, de reconnaissance, de devoir moral. En langage diplomatique, cela signifie : on va poser une plaque commémorative, organiser un colloque, peut-être envoyer quelques technocrates en mission. Mais de réparations concrètes ? Rien. Pas un mot. Pas un chiffre. Bien que la France ne soit plus une monarchie, les contorsions de Macron nous font penser qu’il est le digne héritier du roi Charles X, celui par qui tout ce scandale a commencé.
Les acrobaties présidentielles pour éviter de payer la facture ne datent pas d’hier. En 2015 déjà, François Hollande, en visite à Port-au-Prince, avait lui aussi osé effleurer le sujet. Il avait même reconnu « la dette morale » de la France envers Haïti. Avant de rétropédaler violemment dès son retour à Paris, affirmant qu’il n’était pas question de remboursement financier. Pourquoi ce brusque revirement ? Parce qu’on a fait les comptes. Parce que la vérité, une fois chiffrée, coûte trop cher.
Aujourd’hui, la France traverse une crise budgétaire sévère. Le déficit public explose, les agences de notation menacent, et chaque euro d’aide internationale est compté, justifié, filtré. On voit mal Emmanuel Macron, déjà critiqué pour ses politiques sociales, décider unilatéralement de débloquer plusieurs milliards pour Haïti. Alors il parlera. Il compatira. Il exprimera sa solidarité. Et ce sera tout. Mais le problème, c’est que pendant qu’il parle, notre pays s’effondre. Et sans pression, sans mobilisation de la société haïtienne et de ses alliés, le bicentenaire sera juste une date de plus dans notre calendrier des humiliations répétées.
Une occasion historique à ne pas rater (encore une fois)
Il faut le dire sans détour : si les réparations ne sont pas sérieusement mises sur la table en 2025, elles ne le seront probablement jamais. Ce bicentenaire, c’est une fenêtre diplomatique rare. Une brèche qu’il faut forcer. Et cela ne viendra pas de Paris. Cela doit venir de Port-au-Prince, de New York, de Bruxelles. Cela doit venir de la société civile, des intellectuels, des artistes, des universitaires, des jeunes, de la diaspora. Car nos dirigeants, jusqu’ici, ont prouvé leur incompétence à défendre nos droits les plus fondamentaux sur la scène internationale.
On ne leur demande pas de supplier. On leur demande de parler fort. De plaider notre cause avec la légitimité de l’histoire, avec les chiffres, avec le poids du droit. Il est plus que temps de former des alliances. Avec les Caraïbes, avec l’Union africaine, avec les mouvements progressistes européens. Car Haïti n’est pas un cas isolé. D’autres nations ont subi les conséquences du colonialisme économique. Ensemble, nous pouvons créer une pression internationale qui dépasse les gestes symboliques.
Certains diront que c’est utopique. Mais l’utopie, c’est de croire qu’un pays peut survivre en ayant été appauvri dès sa naissance sans jamais recevoir justice. L’utopie, c’est de croire que Macron viendra nous sauver si nous restons silencieux.
Non, rien ne viendra sans lutte. Et surtout, rien ne viendra si l’on continue de baisser les bras devant chaque opportunité historique. Cette fois, il ne faut pas lâcher.
Le passé ne s’efface pas. Il se répare. Et si la France a une dette envers Haïti, ce n’est pas une opinion — c’est un fait. À nous maintenant d’en faire une cause nationale. Car l’histoire jugera moins les coupables que ceux qui, en les connaissant, ont choisi de se taire.
Dessalines Ferdinand & Stéphane Boudin
Le Floridien, 12 avril 2025