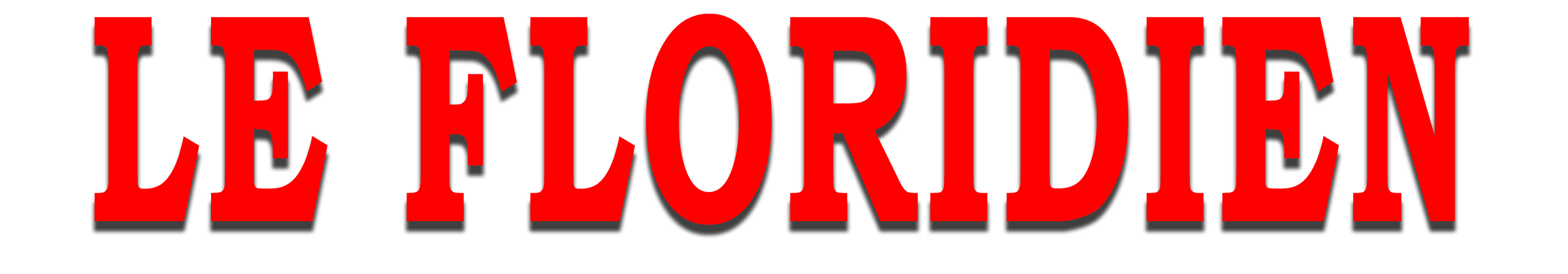Encore une réunion. Encore une déclaration. Encore un espoir sans lendemain. Cette semaine, le Premier ministre Alix Fils-Aimé a convoqué un conseil restreint de son cabinet pour discuter du sujet le plus urgent, le plus symbolique, le plus attendu : le calendrier électoral. Mais à la sortie de cette séance, aucune avancée. Rien de concret, rien de tangible. Des promesses, des formules vagues, des engagements flous. Une habitude nationale, devenue presque un art de gouverner : parler beaucoup, agir peu.
Pendant ce temps, la question qui hante chaque coin de rue, chaque maison, chaque radio communautaire, reste sans réponse : à quand les élections ? Pas dans l’absolu. Pas théoriquement. Mais quand, précisément, les citoyens pourront-ils glisser un bulletin dans l’urne, voter pour un parlement, un président, des maires, des députés ? Quand la transition politique cessera-t-elle d’être un cercle sans fin, une fuite en avant maquillant l’immobilisme ?
Ce qui se joue ici n’est pas qu’un calendrier technique. C’est une question de confiance. Depuis trop longtemps, les Haïtiens vivent dans une sorte de république provisoire perpétuelle, où tout le monde parle de changement, mais où personne ne pose les fondations. L’état d’urgence politique est devenu le quotidien. Et le gouvernement provisoire, lui, se contente de gérer le chaos, faute de mieux.
Or, sans élections, il n’y a pas de retour à la légitimité. Sans légitimité, pas de gouvernance stable. Sans gouvernance stable, pas de confiance des citoyens, pas d’investissement, pas de reconstruction. Tout est lié. Tout commence par un acte simple, mais essentiel : donner au peuple la possibilité de choisir.
Et pourtant, ce simple principe semble inaccessible. Chaque gouvernement de transition promet de préparer les élections. Chaque commission mise en place affirme travailler à leur organisation. Chaque communiqué en appelle à la responsabilité. Mais au final, rien ne bouge. Les mêmes formules sont répétées, recyclées, jusqu’à perdre toute substance. On déplore les retards, on invoque les “conditions sécuritaires”, on agite la menace des gangs comme si elle était nouvelle, comme si elle suffisait à bloquer tout processus.
Le problème n’est pas l’insécurité. Il est plus profond : c’est l’absence de volonté politique réelle. Organiser des élections, c’est prendre le risque de perdre le pouvoir. C’est être prêt à se soumettre au verdict populaire. Et manifestement, dans les cercles du pouvoir, ce courage-là est rare.
Il faut aussi dire les choses telles qu’elles sont : certains bénéficient de ce vide. L’absence d’élections permet à des responsables de prolonger leur mandat sans devoir rendre de comptes. Elle permet de gérer par décret, de gouverner sans contrôle parlementaire, de nommer sans être contesté. En bref, elle facilite un pouvoir sans contre-pouvoir. À qui profiterait vraiment un retour à la normalité ?
Dans cette situation, ce n’est pas seulement l’avenir d’Haïti qui est en jeu. C’est sa crédibilité, sa souveraineté, sa capacité à redevenir une nation gouvernée. Chaque jour sans élection est un jour de plus où l’État recule. Et plus il recule, plus les groupes armés avancent, plus les citoyens se détournent, plus l’exil devient tentant. Le pouvoir ne peut pas prétendre être la solution s’il repousse sans cesse l’outil fondamental de toute solution : le vote.
Le Premier ministre Fils-Aimé, comme ses prédécesseurs, avait promis de tout faire pour remettre le pays sur la voie de la stabilité. Mais la stabilité ne peut pas reposer sur des conseils de ministres en vase clos ni sur des discours bien tournés. Elle exige un cap clair, un calendrier, une transparence dans les étapes, des dates, des actes. Rien de tout cela n’est en vue aujourd’hui. La réunion de cette semaine n’était qu’un nouvel épisode dans la série des illusions entretenues.
Il est temps de nommer ce que tout le monde murmure : l’État haïtien est en panne. Il tourne à vide. Et plus personne ne semble tenir le volant. Ou plutôt, trop veulent conduire en même temps, dans des directions opposées. Le résultat ? Un blocage prolongé, et un peuple désabusé qui regarde ce cirque institutionnel où les questions essentielles sont sans cesse différées.
Dans les rues, la colère gronde, mais elle se mêle à une lassitude généralisée. Les Haïtiens ne croient plus aux promesses, parce qu’elles n’ont jamais été tenues. Et pourtant, ils attendent. Une date. Un signal. Une preuve que leur voix compte encore. Que le pays n’est pas condamné à l’éternelle transition.
Si le gouvernement veut éviter une rupture définitive entre l’État et la population, il doit sortir de l’ambiguïté. Il doit dire clairement où il va, avec qui, comment, et quand. Et surtout, il doit comprendre que le temps du provisoire est terminé. Il faut une feuille de route. Il faut un calendrier électoral. Et il le faut maintenant.
Autrement, les Haïtiens continueront de poser la même question, jour après jour : À quand les changements ? Et cette question, un jour, se transformera en révolte.
Stéphane Boudin