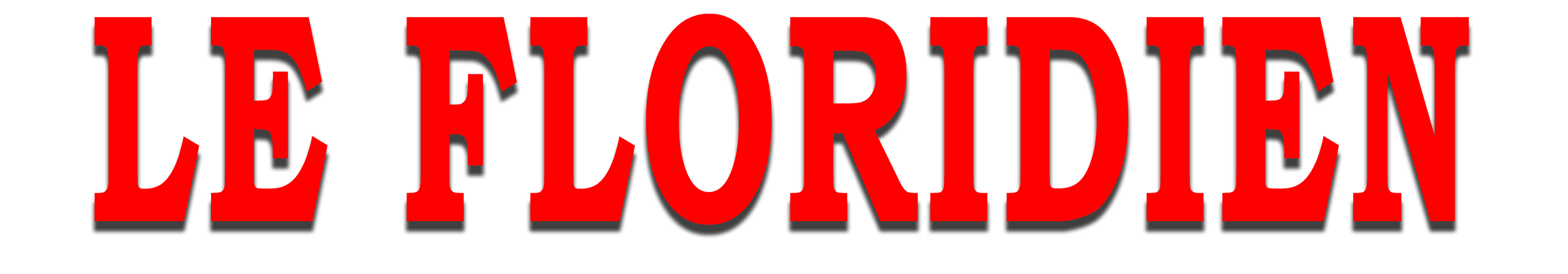Par Le Floridien
MIAMI — Le décès tragique du policier kényan Benedict Kabiru, deuxième membre des forces kényanes à perdre la vie sur le sol haïtien, tué lors d’une embuscade en Haïti le mois dernier, met crûment en lumière une réalité que beaucoup redoutaient déjà : le président kényan William Ruto a surestimé la capacité de ses troupes à rétablir l’ordre dans un pays ravagé par des années de violence, d’abandon institutionnel et d’ingérence étrangère.
En octobre 2023, avec un ton assuré et presque triomphant, Ruto annonçait que le Kenya était prêt à prendre les rênes de la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MSS) en Haïti. Il évoquait une mission « d’humanité », préparée avec professionnalisme, visant à secourir un peuple frère. Quelques mois plus tard, les illusions s’effondrent : le terrain haïtien n’est pas un simple exercice de maintien de l’ordre. C’est un bourbier.
La dure réalité d’un terrain sous contrôle des gangs
La mission MSS, soutenue par les Nations unies mais portée logistiquement et politiquement par les États-Unis, s’est engagée tête baissée dans une situation que même les troupes onusiennes n’avaient jamais su maîtriser par le passé — précisons qu’à l’époque, les gangs étaient pourtant moins bien équipés.
À Port-au-Prince, les gangs ne sont plus de simples bandes désorganisées : ils sont lourdement armés, structurés, et solidement ancrés sur le territoire. Ils contrôlent les axes routiers, les quartiers stratégiques, et même des zones d’intérêt économique. Et surtout, ils ne craignent ni les blindés, ni les uniformes étrangers.
Le fait que l’un des premiers policiers kényans déployés ait été tué dans une embuscade, malgré l’encadrement international, en dit long sur le niveau de menace réel. Cela démontre que les forces envoyées sur place n’étaient ni préparées aux conditions locales, ni suffisamment soutenues par une stratégie globale.
Un président trop sûr de lui, un pari mal calculé
Lors de sa visite en Haïti en septembre 2024, le président Ruto déclarait que la sécurité s’était améliorée grâce à l’intervention kényane. Mais les faits le contredisent brutalement. Depuis son départ, la violence n’a pas cessé. Elle s’est même intensifiée, et les organisations humanitaires fuient à mesure que les gangs renforcent leur emprise.
Le chef de l’État kényan voulait positionner son pays comme une force de paix sur la scène internationale. En soi, cette ambition n’a rien de condamnable. Mais encore faut-il avoir les moyens, les partenaires locaux, et surtout la bonne lecture du terrain. À l’heure actuelle, la mission en Haïti semble reposer davantage sur des illusions diplomatiques que sur une compréhension concrète des dynamiques haïtiennes.
Haïti n’est pas un théâtre d’opération standard
Il faut le dire avec clarté : Haïti est un pays en décomposition institutionnelle, un espace où l’État est pratiquement absent, où la justice n’existe plus, et où la population ne fait plus confiance à personne. Dans un tel contexte, espérer « rétablir l’ordre » avec quelques centaines de policiers étrangers relève d’un vœu pieux — voire d’une mise en scène.
Et à ceux qui croient encore qu’il s’agit d’un simple problème de sécurité publique, rappelons que les racines de cette crise sont politiques, sociales et historiques. Aucun déploiement sécuritaire ne pourra réussir sans un vrai plan de reconstruction institutionnelle, ni sans une implication réelle des Haïtiens eux-mêmes dans la recherche de solutions.
Le Kenya doit-il continuer ?
La mort de Benedict Kabiru doit être plus qu’un fait divers tragique. Elle doit servir de signal d’alarme. Combien de morts faudra-t-il pour que Nairobi revoie sa copie ? Quelle est la ligne rouge pour que le gouvernement kényan mette en pause, ne serait-ce que temporairement, son engagement dans cette opération dont les contours restent flous ?
Pour l’instant, le Kenya semble enfermé dans un piège diplomatique et opérationnel, pris entre les attentes de ses partenaires internationaux et la dure réalité du terrain haïtien. Et ce sont les hommes en uniforme, comme Kabiru, qui en paient le prix.
Une leçon pour les Haïtiens aussi
Ce drame pose aussi une question à nous, Haïtiens : jusqu’à quand allons-nous continuer à accepter que des solutions viennent de l’extérieur ? Quand prendrons-nous enfin en main notre destin collectif ? Car aussi irresponsables que soient nos dirigeants, aucune solution importée ne pourra remplacer une refondation réelle, menée par et pour les Haïtiens.