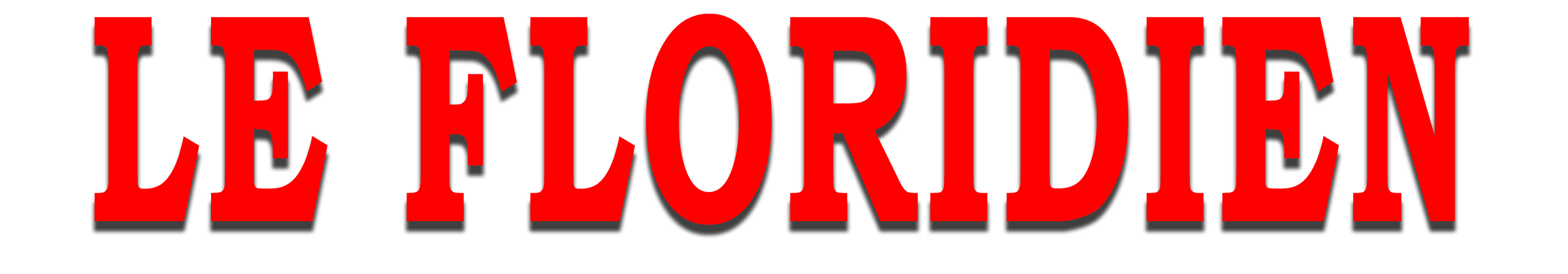La réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche a provoqué un électrochoc au sein de la communauté haïtienne établie aux États-Unis, suscitant un vif débat quant à l’avenir des relations entre les États-Unis et Haïti. Vu les discours que Trump a tenus sur les Haïtiens, l’heure n’est guère à l’optimisme. Au cours de son premier mandat, l’ex-président américain s’était illustré par des commentaires controversés sur les nations caribéennes, laissant présager un manque criant de volonté d’initiative. Et que dire des propos racistes qu’il a entonnés lors de la dernière élection. À présent, de nombreux observateurs redoutent que les États-Unis ignorent encore Haïti, laissant notre pays sombrer davantage dans le chaos.
Un premier mandat marqué par l’indifférence
Donald Trump est un personnage haut en couleur. Soit on aime, soit on déteste. Mais l’homme ne laisse personne indifférent. Pas sûr que le nouveau locataire de la Maison-Blanche soit apprécié par les Haïtiens, surtout après la dernière campagne électorale où il a laissé une image peu reluisante.
Enchaînant les propos désagréables, voire xénophobes, Trump a montré un visage qu’on voit rarement chez une personnalité de ce calibre. Mais ce qui inquiète le plus, c’est la relation qu’il entend entretenir avec les nations limitrophes, à commencer par Haïti. Assez brutal dans sa politique étrangère, l’homme préfère les ‘deals’ plutôt que de s’embarrasser de longues discussions diplomatiques. Quelques heures à peine après ses prises de fonctions, il a formulé des propositions ahurissantes, comme celle de ‘coloniser’ le canal de Panama, d’annexer le Groenland, ou encore d’intégrer le grand voisin canadien en tant que 51e État américain ! Et Haïti dans tout ça ?
On peut dire sans risque de se tromper que les Haïtiens n’attendent pas grand-chose de Trump et son administration au cours des quatre prochaines années. Le bilan du premier passage de Trump à la Maison-Blanche est là pour nous le rappeler. Fidèle à son habitude, ses discours officiels se concentrent plutôt sur les questions intérieures, à savoir la restriction de l’immigration clandestine et la dérégulation de l’économie pour permettre aux riches de s’enrichir davantage. Sur le plan extérieur, la lutte contre la Chine au niveau commercial est devenue une obsession qui inquiète les marchés. Dans ce contexte, Haïti paraît relégué au second plan, sinon au troisième, tant l’agenda américain est accaparé par d’autres dossiers. La note récemment publiée par Marco Rubio, le tout nouveau secrétaire d’État américain, confirme un peu plus la politique étrangère attendue : ‘’Chaque dollar que nous dépensons, chaque programme que nous finançons, chaque politique que nous menons doit être justifié par la réponse à trois questions simples : Est-ce que cela rend l’Amérique plus sûre ? Est-ce que cela rend l’Amérique plus forte ? Est-ce que cela rend l’Amérique plus prospère ? ‘’. En clair, America First.
Ce révisionnisme de la politique étrangère pourrait impacter des agences comme l’USAID, ainsi que d’autres agences de développement, qui subiront des coupes drastiques des fonds qui leur sont alloués. Si en plus, Trump et ses acolytes, dont un certain Elon Musk, décident de sabrer davantage les ressources des organisations internationales travaillant en Haïti, ces dernières auront encore plus de mal à remplir leur mission déjà ardue. Ainsi, l’annonce faite par la nouvelle administration de sortir de l’OMS peut présager des conséquences négatives sur notre pays, mais aussi sur d’autres nations vulnérables qui dépendent elles aussi de l’aide extérieure.
La révocation du TPS est un autre sujet qui préoccupe particulièrement la communauté haïtienne. Des milliers de nos compatriotes présents sur le sol américain risquent de se retrouver du jour au lendemain sous la menace de l’expulsion. Or, un retour massif vers Haïti, déjà incapable d’absorber sa propre population, pourrait aggraver l’instabilité ambiante. Pour ainsi dire, le second mandat de Trump n’augure rien de bon.
Le repli américain annonceur d’une aggravation de la situation en Haïti
Alors que l’administration Trump se concentre sur ses priorités internes, la situation sur le terrain en Haïti ne cesse de se dégrader. L’explosion des violences liées aux gangs, la raréfaction des denrées de base et l’effondrement progressif de l’État soulignent l’urgence d’une action concertée. Pourtant, depuis son investiture, Trump semble incarner une forme de repli isolationniste, préférant miser sur des politiques protectionnistes et des alliances commerciales rivées sur l’intérêt strictement américain. Dans ce schéma, Haïti ne pèse pas lourd, faute de ressources naturelles stratégiques ou d’un marché juteux qui pourraient attirer les entreprises américaines. Les enjeux sont pourtant colossaux : crise économique, violences endémiques, effondrement des structures étatiques. Cette conjugaison explosive menace non seulement la stabilité haïtienne, mais aussi la région tout entière, à commencer par les États-Unis. Et ça, notre cher Donald ne semble pas l’avoir inclus dans ses calculs.
Face à cette menace croissante, on aurait pu s’attendre à ce que l’administration Trump fasse au moins semblant de s’impliquer, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité nationale. Or, il n’en est rien. Même la diplomatie américaine demeure discrète sur la situation, se contentant souvent de diffuser des communiqués laconiques qui appellent les différentes factions haïtiennes au dialogue. L’absence de leadership des États-Unis crée un vide que tentent parfois de combler d’autres acteurs internationaux comme l’ONU, bien que cette dernière se montre prudente après l’échec des précédentes missions de maintien de la paix. Pour ainsi dire, l’immobilisme américain sous Trump II rendra le terrain encore plus glissant pour un pays déjà à genoux.
Et si Trump nous poussait à ne compter que sur nous-mêmes ?
En Haïti, les acteurs locaux – partis politiques, organisations de la société civile, diaspora, églises – scrutent avec angoisse les rares signaux émis par Washington. Or, entre quelques tweets lapidaires et les discours chaotiques de l’administration, on peine à distinguer une direction claire. Ce qui est sûr, c’est qu’Haïti reste hors du radar national, sauf lorsqu’il s’agit d’organiser des expulsions express et massives pour enchanter l’électorat républicain.
Des élus au Congrès militent pour un sursaut humanitaire, soutenant qu’un effondrement total de l’île porterait un coup grave à la crédibilité américaine, mais aussi à sa sécurité. Pas sûr que Trump ait une vision stratégique aussi élaborée. Sa philosophie est assez simple : on frappe d’abord, et on réfléchit après. Une façon de faire assez primitive, qui débouche la plupart du temps sur des résultats désastreux.
Au final, Trump II pourrait sceller un constat pour le moins fataliste : notre pays doit se débrouiller seul, sans le soutien actif d’une Amérique concentrée sur ses priorités internes. Haïti n’en est pas à sa première tragédie, mais la vulnérabilité actuelle est telle qu’un naufrage semble de plus en plus probable. La résilience de notre peuple reste immense, forgée par des décennies d’épreuves. Mais sans l’ombre d’un appui extérieur, cette résilience peut s’éroder et céder la place à un chaos encore plus profond.
Cela étant dit, certains analystes estiment qu’une mobilisation plus forte de la diaspora haïtienne aux États-Unis pourrait influencer les choix de l’administration Trump, surtout à l’approche d’échéances électorales sensibles de mi-mandat. Des voix issues d’États-clés rappellent à Washington que négliger Haïti comporte un risque politique. Reste à voir si ce lobbying parviendra à infléchir une tendance ancrée. Pendant ce temps, Haïti s’enfonce dans l’incertitude, tandis que le monde observe, impuissant !
Stéphane Boudin et Dessalines
Ferdinand / Le Floridien